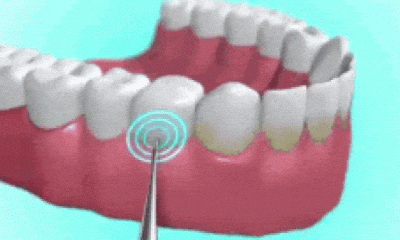Olivier Bonnot est professeur des universités praticien hospitalier en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Nantes, et secrétaire général du Collège national des universitaires de psychiatrie.
Quels sont les enseignements à tirer du suicide de cette adolescente, le 26 janvier à l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ?
Tout d’abord, il ne faut pas oublier les chiffres des dépressions chez les adolescents, de l’ordre de 10 %. C’est une pathologie endémique dont la connaissance reste assez mauvaise, tant dans la société que dans le milieu médical. On ne parle pas assez de la dépression, il n’y a jamais de campagne aux heures de grande écoute pour dire de consulter si on a des idées suicidaires, alors qu’il y en a pour dépister le cancer colorectal.
Par ailleurs, il faut savoir que ce n’est pas parce qu’on pose la question des idées suicidaires à quelqu’un qu’il va passer à l’acte. En parler ne les déclenche pas ; au contraire, cela peut soulager. Personne ne simule quand il parle de ça.
Existe-t-il des protocoles de gestion de la crise suicidaire à l’hôpital ?
Oui, il y a des formations dispensées, notamment aux infirmiers. On leur dit par exemple que répondre « vous avez tout pour être heureux », c’est culpabilisant et inutile face à quelqu’un en dépression. Il s’agit donc d’en parler, puis d’évaluer la gravité, la force, le niveau d’antériorité des idées suicidaires. Ce n’est pas la même chose de dire « j’en peux plus j’ai envie de mourir », et d’avoir réfléchi à comment acheter une corde, où la suspendre, et au fait qu’il n’y avait pas d’infirmier dans le service entre 6 h 30 et 7 heures le matin pour pouvoir faire ça tranquille.
Mais le risque de suicide est inhérent aux soins des pathologies mentales. On empêche tous les jours des suicides dans tous les services de psychiatrie de France. Tous les soignants vivent sans arrêt avec cette idée en tête, c’est notre plus grande peur, celle d’un patient laissé sans surveillance, ou qu’on a laissé sortir, parce qu’il manque aussi des places. Il m’arrive de devoir faire des arbitrages, d’être un peu inquiet de ne pas avoir pu hospitaliser un patient, et d’être soulagé de l’avoir au téléphone le lendemain.
Est-ce que le manque chronique de lits en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a des conséquences sur la pédiatrie ?
Les services de pédiatrie sont sensibilisés à ces problématiques, mais l’environnement n’est pas forcément très adapté : les repas sont servis en chambre, il n’y a pas d’activités thérapeutiques, pas le même encadrement. De toute façon, on n’a pas le choix, il y a un tel manque de pédopsychiatres ! On s’apprête à en perdre la moitié en dix ans. Ça n’est même plus une question d’argent, mais de personnes. Et il faut dix ans pour former un médecin…
Source : lemonde